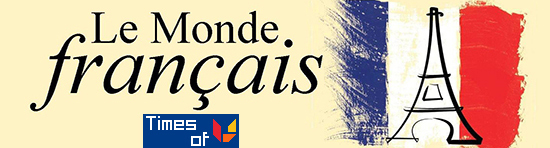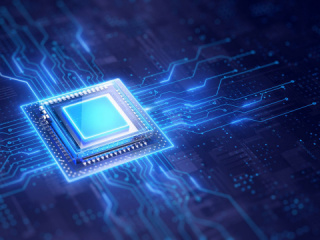Les semi-conducteurs, ou puces, sont des composants essentiels dans tous les domaines, des smartphones et ordinateurs aux systèmes militaires et à l’intelligence artificielle, ce qui fait du contrôle de leur production et de leur approvisionnement une question de sécurité nationale et de domination économique.
La «guerre des puces» fait référence à la concurrence géopolitique et économique croissante pour la technologie des semi-conducteurs, principalement entre les États-Unis et la Chine, mais impliquant également d’autres pays comme le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et les Pays-Bas.
La guerre des puces électroniques résulte d’une combinaison de facteurs stratégiques, économiques et technologiques, car les semi-conducteurs sont le fondement des économies modernes et des capacités militaires.
Les semi-conducteurs alimentent des systèmes militaires avancés, notamment des systèmes de guidage de missiles, des drones et des systèmes de guerre basés sur l’intelligence artificielle. Les États-Unis craignent que l’accès de la Chine à des puces avancées n’étende les capacités de l’Armée populaire de libération, au point de dépasser potentiellement la puissance militaire américaine.
La stratégie chinoise de «fusion militaro-civile» (MCF) intègre les avancées technologiques commerciales dans l’infrastructure de sécurité nationale, ce qui suscite des inquiétudes quant au potentiel de militarisation des technologies à double usage (à la fois civiles et militaires).
Les États-Unis souhaitent conserver une avance technologique, comme l’a déclaré en 2022 le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, qui a souligné la nécessité de rester «autant que possible leader» dans les puces logiques et mémoire avancées, s’éloignant de l’approche précédente de «l’échelle mobile» qui consistait à n’avoir que quelques générations d’avance.
Les semi-conducteurs sont l’épine dorsale de l’économie mondiale, dynamisant des secteurs comme l’intelligence artificielle, l’informatique quantique et la 5G. Contrôler la production de puces et l’innovation équivaut à une domination économique.
Les États-Unis considèrent l’essor de la technologie des puces électroniques en Chine comme une menace pour leur domination dans les segments à forte valeur ajoutée de la chaîne de valeur mondiale, où des entreprises américaines telles qu’Intel, Nvidia et Qualcomm détiennent une part de marché importante.
La Chine, en revanche, cherche à devenir autosuffisante pour réduire sa dépendance aux puces étrangères, qu’elle considère comme une vulnérabilité stratégique, en particulier après que les restrictions américaines ont révélé sa dépendance aux importations (la Chine dépense plus en importations de puces qu’en pétrole).
La chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs est extrêmement concentrée : Taïwan (TSMC) produit 92 % des puces les plus avancées au monde (moins de 10 nanomètres) et les Pays-Bas (ASML) monopolisent les machines de lithographie ultraviolette extrême (EUV) essentielles à la production de puces avancées. Cette concentration engendre des risques, notamment dans un contexte de tensions géopolitiques telles qu’une éventuelle invasion chinoise de Taïwan.
Les États-Unis accusent la Chine de vol de propriété intellectuelle et de transfert forcé de technologie, ce qui, selon eux, porte atteinte à l’innovation et à la compétitivité américaines.
Certains craignent que les puces fabriquées en Chine, en particulier dans les infrastructures critiques, puissent contenir des vulnérabilités ou des portes dérobées permettant l’espionnage ou le sabotage.
La guerre des puces électroniques s’inscrit dans une rivalité plus large entre les États-Unis et la Chine pour la domination mondiale, car les deux pays considèrent le leadership technologique comme essentiel pour façonner l’ordre mondial du 21e siècle.
Les États-Unis cherchent à maintenir leur influence sur leurs alliés et partenaires en les unissant contre les ambitions technologiques de la Chine, tandis que la Chine cherche à construire un écosystème technologique alternatif, attirant potentiellement d’autres pays dans son orbite.
Le plan chinois «Made in China 2025» vise à dominer les industries de haute technologie, y compris les semi-conducteurs, pour passer d’un centre de fabrication à bas prix à un leader technologique mondial.
Les subventions importantes de Pékin (47,5 milliards de dollars pour son industrie des puces en 2024) et les investissements dans les puces héritées (technologie plus ancienne) menacent d’inonder les marchés mondiaux, perturbant potentiellement les industries occidentales.
Les États-Unis et d’autres pays ont déployé diverses stratégies pour rivaliser dans la guerre des puces électroniques, allant du contrôle des exportations aux politiques industrielles. La Chine a réagi en prenant des contre-mesures pour atteindre l’autosuffisance et riposter. Voici quelques méthodes clés :
Les États-Unis ont imposé des contrôles stricts à l’exportation pour limiter l’accès de la Chine aux puces et aux équipements de fabrication avancés.
Des restrictions sur les outils d’automatisation de la conception électronique (EDA), les puces avancées et les équipements de fabrication de semi-conducteurs (SME) capables de fabriquer des puces inférieures à 16 nanomètres ont été imposées en octobre 2022. Elles ont également étendu la règle sur les produits directs étrangers (FDPR) à 28 entreprises chinoises et ont interdit aux citoyens américains d’aider les développeurs de puces chinois.
Des entreprises comme Huawei, SMIC et 13 autres (comme Beijing Biren Technology) ont été ajoutées à la liste américaine des entités qui leur interdisent l’accès à la technologie américaine en raison de risques pour la sécurité nationale, notamment dans le domaine du développement de l’intelligence artificielle.
En octobre 2023, les contrôles américains ont été encore renforcés afin de combler les lacunes et d’étendre les technologies soumises à restrictions. Les États-Unis ont appliqué ces contrôles de manière extraterritoriale, faisant pression sur les entreprises étrangères pour qu’elles se conforment sous peine de sanctions, créant ainsi un véritable «empire réglementaire mondial».
Les États-Unis ont convaincu des alliés tels que les Pays-Bas et le Japon de restreindre les exportations de technologies essentielles à la fabrication de puces.
Les Pays-Bas (où se trouve ASML) ont introduit des contrôles à l’exportation sur les équipements de photolithographie à partir du 1er septembre 2023.
Le Japon a restreint l’exportation d’outils avancés pour la fabrication de puces.
Les États-Unis poussent à la création de structures minilatérales, telles que la «Chip 4 Alliance» (États-Unis, Japon, Corée du Sud, Taïwan) ou les formats G7+, pour unir les alliés contre la Chine.
Le CHIPS and Science Act (2022) alloue 280 milliards de dollars pour stimuler la fabrication, la recherche et le développement de semi-conducteurs aux États-Unis, dans le but de réduire la dépendance aux chaînes d’approvisionnement étrangères et de capturer 30 % du marché mondial des puces d’ici 2032.
Les États-Unis ont incité des entreprises comme TSMC à construire des usines en Arizona, même si ces installations ne produiront qu’une fraction de la capacité de TSMC à Taïwan (3 % de la production totale).
L’accélérateur d’investissement américain, créé par le décret exécutif 2025, supervise la fabrication de semi-conducteurs pour garantir un alignement stratégique.
L’administration Biden a doublé les tarifs douaniers sur les semi-conducteurs chinois de 25 % à 50 % d’ici 2025 pour contrer une surabondance potentielle de puces chinoises obsolètes sur le marché.
Les droits de douane sur les produits chinois, imposés sous Trump en 2018, ont été maintenus pour exercer une pression économique sur la Chine, même s’ils ont augmenté les coûts pour les consommateurs américains.
Les États-Unis ont restreint l’accès des chercheurs chinois dans leurs universités et lancé l’«Initiative Chine» (2018) pour lutter contre les allégations d’espionnage économique, bien que cela ait suscité des inquiétudes quant à l’étouffement de l’innovation en restreignant les talents chinois.
La Chine a investi des milliards dans son industrie des puces électroniques, dont un fonds de 47,5 milliards de dollars en 2024 et 143 milliards de dollars de subventions pour développer sa propre chaîne d’approvisionnement.
L’accent mis sur les puces héritées (nœuds plus anciens) a permis à la Chine de dominer ce segment, produisant 1 milliard de puces par jour pour un usage national et inondant potentiellement les marchés mondiaux.
Des innovations comme la puce 7 nm de SMIC et les puces IA de Huawei (malgré les restrictions américaines) démontrent des progrès vers l’autosuffisance.
La Chine a restreint ses exportations de gallium et de germanium, minéraux essentiels à la production de puces électroniques, en 2023 afin de mettre sous pression les industries technologiques occidentales. Cependant, les experts estiment que cette mesure pourrait avoir un impact limité à long terme grâce à l’existence d’autres sources mondiales.
La Chine a interdit l’utilisation des puces Micron dans ses infrastructures critiques en mai 2023, invoquant des risques de sécurité affectant un fournisseur américain clé.
Les entreprises chinoises ont accumulé des stocks d’équipements semi-conducteurs en provenance des Pays-Bas, du Japon et d’autres pays avant l’entrée en vigueur des contrôles à l’exportation, profitant des retards et des exceptions.
La Chine explore des solutions innovantes, comme le projet de l’Université Tsinghua de construire un accélérateur de particules pour la production de puces afin de contourner les limites de la lithographie occidentale.
La directive chinoise «Remove America» exige que les entreprises publiques remplacent les logiciels et le matériel étrangers, ce qui encourage l’adoption de technologies nationales.
Les lois anti-espionnage élargies à partir de 2023 ciblent les menaces perçues pour la sécurité nationale, décourageant les investissements étrangers mais renforçant les contrôles sur la technologie.
Sous la pression des États-Unis, les Pays-Bas et le Japon ont restreint leurs exportations d’équipements de fabrication de puces vers la Chine. Les Pays-Bas se concentrent sur les machines EUV d’ASML et le Japon sur les outils de précision. Ces restrictions visent à préserver leur avantage technologique tout en s’alignant sur les efforts américains visant à contenir les ambitions chinoises en matière de puces.
Le groupe taïwanais TSMC domine la production de puces avancées et diversifie ses opérations, en construisant des usines aux États-Unis, au Japon et en Europe pour atténuer les risques géopolitiques.
La Corée du Sud (qui abrite Samsung et SK Hynix) équilibre sa coopération avec les États-Unis et ses liens commerciaux avec la Chine, bénéficiant du CHIPS Act tout en contrôlant ses exportations.
L’Inde apparaît comme un acteur potentiel, s’associant aux États-Unis pour construire une «chaîne de valeur fiable» et mettre en œuvre un modèle d’État pour développer son industrie des puces électroniques.
Des pays comme l’Allemagne et l’UE investissent dans la fabrication nationale de puces (par exemple, les huit projets de semi-conducteurs de l’Allemagne) pour réduire leur dépendance à l’égard de l’Asie, en s’alignant sur les objectifs américains mais en donnant la priorité à la sécurité économique.
Si les contrôles à l’exportation américains ont ralenti les progrès de la Chine dans le domaine des puces avancées, ils ont également poussé la Chine à innover dans les puces héritées et les technologies alternatives, créant potentiellement un double écosystème de semi-conducteurs.
Les restrictions pourraient se retourner contre eux, en réduisant la part des entreprises américaines sur le marché chinois (par exemple, en excluant Nvidia), en incitant les fabricants de puces non américains et en aliénant les alliés qui craignent les coûts économiques.
Le recours excessif au contrôle extraterritorial risque d’aggraver les alliances, alors que des pays comme la Corée du Sud et les Pays-Bas sont confrontés à des pertes économiques dues à la réduction des échanges commerciaux avec la Chine.
Malgré les progrès réalisés, la Chine accuse un retard dans la fabrication de puces électroniques de pointe en raison d’un accès limité aux équipements et à l’expertise en ultraviolet extrême (EUV). La mise en place d’une chaîne d’approvisionnement entièrement nationale pourrait coûter mille milliards de dollars et est entachée d’inefficacités et de scandales de corruption (par exemple, celui du Big Fund).
L’approche de Xi Jinping, principalement centrée sur l’État, pourrait étouffer l’innovation du secteur privé, comme le montre la répression contre les entrepreneurs technologiques comme Jack Ma.
La guerre des puces menace de fragmenter la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs en blocs dirigés par les États-Unis et la Chine, faisant grimper les coûts et étouffant l’innovation.
Des alliés comme Taïwan, la Corée du Sud et les Pays-Bas se sont retrouvés pris entre deux feux, entre leurs liens économiques avec la Chine et la pression américaine.
De nouveaux acteurs comme l’Inde pourraient bénéficier de la restructuration des chaînes d’approvisionnement, mais la concentration de la fabrication de puces avancées à Taïwan reste un point chaud géopolitique.
La guerre des puces électroniques entre les États-Unis et d’autres pays, dont la Chine, est motivée par des préoccupations de sécurité nationale, de domination économique et de chaîne d’approvisionnement, les semi-conducteurs étant un champ de bataille pour la supériorité technologique.
Les États-Unis utilisent les contrôles à l’exportation, la coordination entre leurs alliés et les investissements nationaux pour maintenir leur avance, tandis que la Chine riposte par des efforts d’autosuffisance, des restrictions de rétorsion et l’innovation dans les puces électroniques traditionnelles. D’autres pays, comme les Pays-Bas, le Japon, Taïwan et l’Inde, jouent un rôle crucial dans l’orientation de la concurrence pour défendre leurs propres intérêts.
Mais la guerre risque de fragmenter les chaînes d’approvisionnement mondiales, d’augmenter les coûts et d’entraîner des conséquences imprévues, alors que les deux camps peinent à concilier sécurité et réalités économiques. L’issue reste incertaine, mais les enjeux – le contrôle de la technologie la plus importante au monde – sont sans précédent.
© Le Monde français